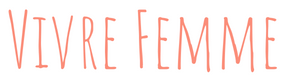En 2010, la France était au bord d’une amende record de 20 milliards d’euros de la part de l’Union européenne. Motif ? Son électricité était trop bon marché. Trop compétitive. Trop propre. Une situation inédite, presque absurde, mais parfaitement réelle. Pour éviter cette sanction, Paris a cédé à la pression bruxelloise et voté la loi NOME, censée ouvrir le marché à la concurrence. Résultat ? Un chaos régulé : explosion des tarifs, affaiblissement d’EDF, et perte de souveraineté énergétique. Aujourd’hui, alors que les factures grimpent, une question revient avec force : et si la solution ne venait pas de Bruxelles, mais d’un retrait maîtrisé ?
2010 : quand l’UE menace la France pour son électricité bon marché
L’année 2010 marque un tournant. L’Union européenne, via la Commission de Bruxelles, met en demeure la France. Selon ses services, le modèle d’EDF — fondé sur le nucléaire à bas coût et un tarif régulé accessible — fausse la concurrence sur le marché intérieur de l’énergie. En clair, les autres pays, souvent dépendants du gaz ou du charbon, ne peuvent pas rivaliser. La France vend son électricité à un prix inférieur à celui du marché, ce qui, selon l’UE, constitue une “aide d’État déguisée”.
Vidéo extraordinaire à diffuser partout ! (cf vidéo ⤵️)
« En 2010, la France était menacée par l’UE d’une amende de 20 milliards d’euros car elle avait un prix de l’électricité trop compétitif ! »
« Alors sous la contrainte elle a fait voter la loi NOME qui a désorganisé… pic.twitter.com/QEg3qjAwHf
— Florian Philippot (@f_philippot) July 31, 2025
Une amende de 20 milliards d’euros est alors évoquée, l’une des plus lourdes jamais envisagées dans le domaine énergétique. Face à cette pression, le gouvernement français, alors dirigé par Nicolas Sarkozy, choisit de céder. La réponse s’appelle la loi NOME — Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité — votée en décembre 2010.
La loi NOME : une réforme censée libéraliser, mais qui a tout désorganisé
La loi NOME avait un objectif affiché : ouvrir le marché de l’électricité à la concurrence, garantir un accès équitable aux réseaux, et protéger les consommateurs. En pratique, elle a imposé à EDF de céder une partie de sa production à ses concurrents — Engie, TotalEnergies, ou encore des fournisseurs alternatifs — à un prix forcé, dit d’“obligation d’achat” (ARENH).
Ce mécanisme, censé favoriser la concurrence, a eu des effets pervers. D’abord, il a privé EDF de revenus essentiels pour maintenir et moderniser son parc nucléaire. Ensuite, il a permis à des acteurs privés de revendre de l’électricité produite à bas coût par EDF, sans avoir investi dans la construction ou la maintenance des centrales. Ces “concurrents-sangsues”, comme les qualifient certains économistes, ont profité d’un modèle public pour faire du profit privé.
Le résultat, à long terme, est aujourd’hui visible : sous-investissement dans le nucléaire, vieillissement du parc, perte de compétitivité, et hausse des prix pour les ménages.
Conséquences : explosion des tarifs et affaiblissement d’EDF
Entre 2010 et 2025, le prix de l’électricité pour les ménages a augmenté de plus de 70 %, selon l’Observatoire de la régulation des secteurs de l’énergie (CRE). Pendant ce temps, EDF, autrefois fleuron de l’industrie française, s’est retrouvé endetté à hauteur de plus de 60 milliards d’euros, contraint de dépendre de l’État pour survivre.
Le modèle public, vertueux et compétitif, a été sacrifié sur l’autel de la concurrence européenne. Pendant que la France exportait de l’électricité bon marché, elle importait des règles qui détruisaient sa propre souveraineté. En 2022, lors de la crise énergétique post-guerre en Ukraine, ce manque de contrôle s’est traduit par des pics de prix records, alors même que le pays dispose du parc nucléaire le plus important d’Europe.
FREXIT énergétique : une solution sérieuse ou une utopie ?
Face à cette situation, des voix s’élèvent pour réclamer un changement de cap. Certains, comme l’économiste Thomas Porcher, défendent une sortie partielle du marché européen de l’électricité, afin de retrouver une tarification souveraine. D’autres, comme Jean-Luc Mélenchon, appellent à la remunicipalisation des services énergétiques. Plus radicalement, le mot d’ordre du #FREXIT gagne en visibilité, notamment sur les réseaux sociaux.
L’idée ? Sortir du marché intérieur de l’énergie de l’UE pour retrouver la main sur le prix, la production, et la distribution. Un scénario complexe, juridiquement risqué, mais qui résonne auprès d’un public de plus en plus critique vis-à-vis de l’Europe technocratique.
Le débat n’est plus marginal. Il traverse les émissions comme On n’est pas couché ou C dans l’air, et s’invite dans les campagnes électorales. Car derrière l’énergie, c’est la question de la souveraineté nationale qui est posée.
Vers une reconquête de l’indépendance énergétique ?
La France produit encore plus de 65 % de son électricité grâce au nucléaire — un atout colossal en termes de stabilité et de faible émission de CO₂. Pourtant, elle ne parvient pas à en tirer un bénéfice économique durable. Le paradoxe est criant : le pays le plus nucléarisé d’Europe paie parmi les prix les plus élevés.
Des solutions existent : renationaliser la gestion du réseau, réformer ou suspendre l’ARENH, investir massivement dans le nucléaire de nouvelle génération (EPR2), et créer un tarif social garanti par l’État. Mais elles nécessitent une volonté politique forte — et une rupture avec les dogmes bruxellois de libre concurrence.
Le témoignage de cette époque où la France a été punie pour son efficacité reste un symbole puissant. Il rappelle que parfois, être trop bon peut coûter cher… quand on est coincé dans un système qui valorise la marchandisation plutôt que la performance.