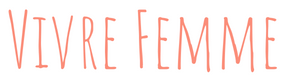Il est 23h37. Une rame de bus arrive en basculant sous la pluie fine de la capitale. À l’intérieur, une jeune femme serre son sac, baisse légèrement la tête, et allume son téléphone. Ce n’est pas pour répondre à un message. C’est pour filmer. Pour témoigner. Pour ne plus être seule face à ce qu’elle appelle “l’enfer des transports de nuit”. Ce qu’elle capture, entre la Gare de l’Est et son quartier, n’est ni une exception ni un accident. C’est un quotidien vécu par des milliers de femmes en France. Un mélange d’incivilités, de regards insistants, de remarques déplacées, et de peur sourde qui monte, minute après minute. Ce témoignage, diffusé sur les réseaux, fait aujourd’hui trembler les réseaux sociaux — et interpelle les autorités.
Le témoignage de Léa ne demande pas la peur, mais la reconnaissance. Reconnaître que les transports ne sont pas neutres. Qu’ils peuvent être un espace de domination. Et qu’il est temps d’agir — avant qu’un autre “ils vont me manger” ne devienne une tragédie.
TRANSPORTS | ️ »Ils vont me MANGER »
Une femme témoigne de l’ENFER des transports de nuit à Gare de l’Est en filmant son périple, entre multiplications des incivilités et dragues malaisantes. pic.twitter.com/pX7RZjt3FJ— SIRÈNES (@SirenesFR) July 27, 2025
Un périple filmé en direct : le calvaire d’une passagère à la Gare de l’Est
La scène se déroule un jeudi soir ordinaire. La Gare de l’Est, comme souvent à cette heure, est un lieu de transition entre la journée qui s’achève et la nuit qui s’installe. Passagers en transit, usagers des dernières rames, touristes désorientés, mais aussi groupes bruyants, comportements agressifs, et une sensation diffuse d’insécurité.
C’est là que Léa*, 28 ans, journaliste pigiste, décide de filmer son retour en bus. Pas pour faire du buzz. Mais parce qu’elle en a “assez de faire semblant que tout va bien”. À la caméra, elle décrit ce qu’elle vit : des hommes qui s’approchent trop près, qui “balancent des regards comme des coups”, qui ricanent quand elle change de place. Un passager lui lance : “Tu veux pas t’asseoir à côté de moi ? T’es trop mignonne pour avoir peur.” Elle répond sèchement : “Non, merci.” Le silence qui suit est lourd. Puis une voix dans le fond murmure : “Elle va me manger, celle-là.”
“Ils vont me manger”, répète-t-elle plus tard dans la vidéo, en chuchotant, le regard fixé sur l’écran. Une phrase simple, mais qui résume tout : la peur, l’impuissance, la sensation d’être prise en chasse.
Des incivilités à répétition, mais aussi une insécurité croissante
Ce que Léa filme n’est pas isolé. Ce sont des comportements récurrents, documentés depuis des années par des associations comme Osez le féminisme ! ou Stop Harcèlement de rue. Dans les transports en commun, surtout en soirée, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à déclarer se sentir en insécurité, selon une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).
À la Gare de l’Est, point névralgique desservi par le RER B, le métro 4, 5 et 7, et de nombreuses lignes de bus, la pression est forte. Les couloirs sont mal éclairés à certaines heures, les agents de sécurité sont visiblement en sous-effectif, et les caméras de vidéosurveillance, bien que présentes, ne suffisent pas à dissuader les comportements déviants.
Harassements verbaux, frôlements suspects, menaces à peine voilées — tout y passe. Et souvent, rien n’est signalé. Par peur, par fatigue, ou par conviction que “de toute façon, personne n’agira”.
Le harcèlement de rue dans les transports : un phénomène sous-estimé
En 2025, plus de 70 % des femmes âgées de 18 à 35 ans déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement dans les transports publics, selon un sondage Ifop pour la Fondation des femmes. Pourtant, moins de 5 % portent plainte. La plupart préfèrent fuir, changer de place, ou éviter certains trajets.
Ce phénomène touche particulièrement les lignes de nuit — Noctilien, bus 38, 46, ou 56 — où la mixité sociale est forte, mais où le contrôle est plus lâche. Des témoignages similaires ont été rapportés à la Gare du Nord, à Châtelet, ou encore à la Défense. Mais c’est à la Gare de l’Est que la situation semble s’aggraver, notamment en raison de la concentration de flux migratoires, de la présence de squats à proximité, et d’un sentiment d’abandon ressenti par les usagers.
Les associations réclament davantage de moyens : plus de personnel de sûreté, des campagnes de sensibilisation, et des dispositifs d’alerte rapides directement intégrés aux applications de mobilité.
Quand le témoignage devient un acte de courage
La vidéo de Léa a été vue plus de 800 000 fois en 72 heures. Elle n’a pas voulu donner son nom complet, par crainte de représailles. Mais elle insiste : “Je veux qu’on arrête de banaliser ça. Ce n’est pas ‘un petit malaise’, c’est une violence systémique. Chaque soir, des femmes retiennent leur souffle dans un bus. Et personne ne dit rien.”
Sa vidéo a déclenché une vague de réactions. Des milliers de femmes ont partagé leurs propres expériences dans les commentaires. “Moi aussi, j’ai eu peur à la sortie du RER B.” “Ils m’ont suivie jusqu’à chez moi.” “J’ai arrêté de prendre le bus après 22h.” Un cri collectif, longtemps étouffé.
Elle a également été relayée par des personnalités comme Clémentine Autain et Adèle Van Reeth, ainsi que par des médias comme France Inter et France 24, qui ont consacré des émissions à la sécurité des femmes dans les transports.
Et maintenant ? Vers une prise de conscience collective ?
Depuis la diffusion de la vidéo, la RATP et la SNCF ont annoncé un renforcement ponctuel des patrouilles à la Gare de l’Est et sur les lignes nocturnes. Un geste, mais insuffisant selon les associations. “Ce n’est pas une question de moyens, c’est une question de volonté politique”, affirme la porte-parole de Féministes en mouvement.
Des solutions existent : des boutons d’alerte dans les bus, des voitures réservées aux femmes la nuit, des campagnes de prévention dans les écoles. Mais elles restent marginales. En Allemagne ou au Japon, ces mesures sont déjà en place. En France, elles butent sur des débats idéologiques.