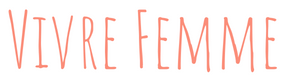Il a tout donné à la SNCF. Des décennies de service. Des années de cotisations. Et pourtant, au moment de profiter de sa retraite, Francis Cazabat s’est retrouvé sans revenu, pris au piège d’un système inflexible. Motif ? Son adresse : une poste restante. Parce qu’il vit dans un camping-car, la caisse de retraite du personnel de la SNCF a refusé de lui verser sa pension, jugeant son domicile “non valide”. Pendant des semaines, ce retraité des Hautes-Pyrénées a vécu dans l’angoisse, menacé de ne plus pouvoir payer son carburant, son chauffage, ni même se nourrir. Une situation ubuesque, injuste, et pourtant révélatrice des failles du système administratif français.
Un mode de vie libre, mais mal compris par l’administration
Depuis 2015, Francis Cazabat a fait du camping-car son foyer. Pas par nécessité, mais par choix. Un désir d’indépendance, de liberté, de mobilité. “Aller où je veux, quand je veux”, résume-t-il. Pour respecter les obligations administratives, il s’est domicilié à la poste restante de Tarbes, une solution légale, reconnue par le Code civil, et utilisée par des milliers de personnes en France — notamment les sans-domicile, les voyageurs, ou les travailleurs nomades.
Jusqu’en 2025, tout fonctionnait. Sa pension était versée chaque mois. Puis, sans avertissement, les paiements ont cessé. “Je suis allé à la poste, il n’y avait rien. J’ai appelé la caisse de retraite : ils m’ont dit que la poste restante n’était pas une adresse valable”, raconte-t-il, encore sous le choc. Une décision brutale, alors même que ni sa situation ni ses documents n’avaient changé.
Une légalité confirmée, mais ignorée
Pourtant, la loi est claire. Le ministère des Affaires sociales a confirmé à plusieurs reprises que la domiciliation en poste restante est légale pour les prestations sociales, y compris les retraites. Le Code de la sécurité sociale ne l’interdit pas. Et pourtant, les organismes de retraite, comme celui de la SNCF, appliquent souvent des règles internes plus restrictives, arguant de risques de fraude ou de difficultés de traçabilité.
Francis Cazabat n’est pas un cas isolé. De nombreux nomades, seniors en mobilité ou personnes en situation précaire rencontrent les mêmes obstacles. “Ils nous traitent comme des suspects alors qu’on a tout fait dans les règles”, déplore-t-il. Pire : ce n’est pas la première fois qu’il est victime d’une erreur administrative. “Ils ont cru que j’étais mort. Ensuite, ils m’ont déclaré disparu. Il a fallu des mois pour régulariser.”
Un combat solitaire pour un droit fondamental
Face au silence de la caisse, le retraité n’a pas baissé les bras. Il a multiplié les appels, les courriers, les relances. Il a contacté un délégué du CHSCT, sa mairie, et prévu un rendez-vous avec le défenseur des droits. Il a même menacé de bloquer des TGV si aucune solution n’était trouvée. “Ma pension, c’est ma survie. J’ai payé toute ma vie. Je ne vais pas me laisser faire.”
Son histoire, relayée par Sud-Ouest, a suscité une vague d’indignation. Beaucoup voient en lui le symbole d’un système qui punit ceux qui sortent des sentiers battus. Un système conçu pour les sédentaires, rigide, incapable d’adapter ses règles à des modes de vie modernes et légitimes.
Une victoire fragile, mais un signal fort
Finalement, après des semaines de lutte, Francis Cazabat a obtenu gain de cause. Le versement de sa pension a été rétabli, avec régularisation des arriérés. Une victoire personnelle, mais aussi collective. Elle montre que la persévérance peut faire plier l’administration. Pourtant, cette issue heureuse ne change pas la règle du jeu.
Combien d’autres, moins déterminés, abandonnent face à l’obstacle ? Combien vivent sans revenu, sans recours, parce qu’ils n’ont pas d’adresse fixe ? Ce cas interpelle : dans un pays qui prône la dignité et la solidarité, peut-on continuer à exclure des citoyens à cause de leur lieu de résidence ?
La mobilité n’est plus une exception. Elle est un mode de vie. Et l’administration doit enfin s’adapter.