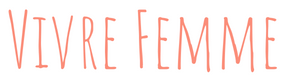Un simple contrôle de billet. Un couple de retraités. Un homme en fauteuil roulant, dépendant d’une assistance respiratoire. Et pourtant, ce voyage en TGV entre Avignon et Rouen a viré au cauchemar. Parce qu’il ne pouvait pas plier le dos, Patrick, 72 ans, a dû manipuler une valise de 15 kg pour sortir sa carte mobilité inclusion. Sous les yeux impassibles d’un contrôleur. Résultat : une blessure au dos, une humiliation, et un questionnement national sur le traitement des personnes en situation de handicap dans les transports. Ce n’est pas un accident. C’est un dysfonctionnement. Et la SNCF, une fois de plus, est au cœur de la tempête.
Un voyage tranquille, jusqu’au contrôle
Marie-Françoise et Patrick, retraités normands, avaient tout prévu. Leur trajet en TGV était réservé, leur carte senior et leur carte mobilité inclusion (CMI) validées, leur assistance à la montée assurée par la SNCF. À Avignon, le personnel les a aidés à embarquer, fauteuil roulant et bagages compris. Tout semblait en ordre.
Pourtant, une fois à bord, le climat a basculé. Un contrôleur, sans ménagement, exige la présentation physique de la CMI. Le document est dans une sacoche, enfermée dans une valise placée au-dessus d’eux. Marie-Françoise explique qu’elle ne peut pas soulever le bagage. Son mari non plus — son état de santé le lui interdit formellement.
Malgré ces explications, l’agent insiste. « Il ne veut rien entendre », raconte-t-elle. « Il me demande d’aller chercher la carte. »
Une demande absurde, une blessure évitable
Face à l’impasse, Patrick décide d’intervenir. Il se redresse tant bien que mal, tend le bras, attrape la valise, tente de l’ouvrir. Dans l’effort, il se blesse au dos. Un geste anodin pour certains, mais potentiellement grave pour un homme dont le médecin a formellement interdit tout effort physique.
« Il risque sa vie en faisant ça », alerte Marie-Françoise. En vain. Le contrôleur, impassible, récupère la carte, constate qu’elle est valide, mais ne présente aucune excuse. Pire : selon le couple, il aurait exprimé sa déception, comme s’il espérait pouvoir leur réclamer un supplément.
Un homme en fauteuil roulant. Une assistance respiratoire. Une CMI inscrite dans le système. Et pourtant, il a dû se blesser pour “prouver” son handicap.
Des excuses tardives, mais insuffisantes
De retour chez eux, le couple tente de signaler l’incident à la SNCF. Sans réponse. Ce n’est qu’après la publication de leur témoignage dans Paris-Normandie et La Dépêche du Midi, relayé par Le Huffington Post, que la direction réagit.
Benjamin Huteau, directeur de l’axe TGV Sud-Est, appelle personnellement Marie-Françoise pour présenter des excuses officielles. Il assure que l’affaire sera transmise aux équipes pour une sensibilisation.
Un geste salué, mais arrivé trop tard. « On ne veut pas d’argent, on veut du respect », insiste la victime. Le problème n’est pas un contrôleur isolé. C’est un système qui, trop souvent, oublie les personnes vulnérables dès que les portes du train se ferment.
Un cas isolé ? Les témoignages se multiplient
Ce n’est pas la première fois que la SNCF est pointée du doigt sur le traitement des voyageurs handicapés. En 2023, un passager aveugle a été laissé seul sur un quai à Lyon. En 2024, une femme en fauteuil a dû attendre 45 minutes pour un escalier mécanique en panne.
Des associations comme APF France handicap ou Handicap Infos Services dénoncent régulièrement un manque de formation des agents. « Les contrôles doivent s’adapter, pas imposer des normes aveugles », affirme une porte-parole.
Or, selon une enquête de l’Autorité des transports urbains (ATU), moins de 30 % des contrôleurs SNCF ont suivi une formation complète sur l’accessibilité. Un chiffre inquiétant, dans un pays où près de 12 millions de personnes vivent avec un handicap.
Et après ? Vers une SNCF plus inclusive ?
La SNCF affirme travailler à l’amélioration de l’accessibilité. Des appels d’urgence, des services d’accompagnement, des applications dédiées. Mais sur le terrain, les failles persistent.
Les voyageurs handicapés ne demandent pas la perfection. Juste la dignité. Qu’on leur fasse confiance. Qu’on ne les oblige pas à souffrir pour prouver leur souffrance.
Comme le rappelle Marie-Françoise : « Mon mari n’a pas besoin de se blesser pour qu’on croie à son handicap. Il est là, visible, permanent. Et pourtant, on l’a forcé à le démontrer. »